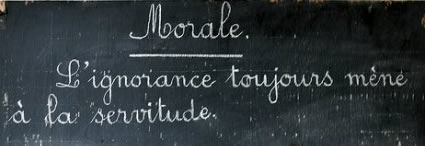Axelos Pour une éthique problématique, Paris, Minuit, 1972, pp. 23-24.
Apparemment, technique et sciences se passent de l'éthique : elles l'expliquent, psychologiquement, historiquement, sociologiquement, et prétendent rendre effectifs ses anciens commandements, dans le processus transformant homme et monde. Psychologie et sociologie, surtout, dévorent avec grand appétit la sphère éthique. Le moral est produit par le social, décrète-t-on, à juste titre d'ailleurs. Sans voir toutefois que le social est aussi produit par le moral. Quasi symétriquement le moral est un résultat du psychique qu'il forme, informe et déforme. Faisant tout cela, sciences et techniques obéissent néanmoins à une éthique inélucidée. Ni les visées, ni les méthodes, ni les contenus de l'activité technoscientifique — à l'exception peut-être de la sphère mathématique pure — ne sont neutres : ils véhiculent une orientation, des « partis pris » initiaux, des intérêts, des idéologies.
De plus, là où cette activité ne croit viser que l'efficacité pratique, elle continue à être mue par une curiosité et une inquiétude qui la propulsent toujours vers l'exploration et l'exploitation de tout ce qui est, que ce soit de manière intéressée ou gratuite — si l'on peut maintenir cette distinction -, que cela rapporte et transforme dans le présent ou que cela prépare un lointain avenir. Les recherches et les enquêtes spatiales, par exemple, ont moins de justification pratique immédiate — elles n'en sont pas tout à fait dépourvues — que d'intérêt apparemment gratuit, tendant à remplir le « vide », tant cosmique qu'humain.
Elles obéissent à la philosophie théorique et pratique de la modernité : devenir maître et possesseur de tout ce qui est, transférer vers le haut les problèmes insolubles d'ici-bas, affronter le néant. L'éthique de la volonté de puissance et de la volonté de volonté qui régit l'homme moderne et la technique planétaire se manifeste dans toutes les branches du savoir et de la science, théoriquement et pratiquement, pendant que sciences et technique veulent prendre en charge l'éthique, la constituer, la réglementer. Que devient dans cette configuration le problème éthique ? Quel est le lieu à partir d'où rayonne sa question ? Ce problème et ce lieu subsistent-ils encore, ou sont-ils d'ores et déjà organisés et administrés technoscientifiquement ?