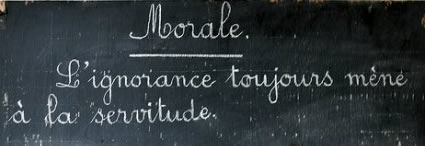Aristote,Éthique à Nicomaque, L, IX, Chap. 9.
Nous avons dit, en effet, au commencement, que le bonheur consiste dans une certaine activité ; et il est facile de voir que l'activité est un devenir, et qu'elle n'est pas en nous comme une chose qu'on possède. Le bonheur consiste donc dans la vie et l'activité, et l'activité de l'homme de bien est vertueuse et plaisante par elle-même — comme nous l'avons dit en commençant. Mais, par ailleurs, ce qui nous est propre est parmi les choses qui nous font plaisir. D'autre part nous sommes plus capables de contempler ceux avec qui nous vivons que de nous contempler nous-même, leurs actions que nos propres actions ; et les actes des hommes vertueux qui sont leurs amis font plaisir aux gens de bien (puisque ces actions possèdent les deux agréments naturels qu'on vient de dire). Donc, de tels amis seront nécessaires à celui qui est parfaitement heureux, puisqu'il se plaît particulièrement à contempler des actions vertueuses et qui lui soient propres, et que les actions de l'homme de bien qui est son ami ont précisément ces deux qualités.
------------------
On a donc raison de dire que c'est par l'accomplissement des actions justes qu'on devient juste, et par l'accomplissement des actions modérées qu'on devient modéré, tandis qu'à ne pas les accomplir nul ne saurait jamais être en passe de devenir bon. Mais la plupart des hommes, au lieu d'accomplir des actions vertueuses, se retranchent dans le domaine de la discussion, et pensent qu'ils agissent ainsi en philosophes et que cela suffira à les rendre vertueux : ils ressemblent en cela aux malades qui écoutent leur médecin attentivement, mais n'exécutent aucune de ses prescriptions. Et de même que ces malades n'assureront pas la santé de leur corps en se soignant de cette façon, les autres non plus n'obtiendront pas celle de l'âme en professant une philosophie de ce genre.
------------------------
Les uns identifient le bien au plaisir ; d'autres, au contraire, l'assurent foncièrement mauvais ; les uns, sans doute par conviction intime, les autres, à la pensée qu'il vaut mieux, vu les conséquences pour notre vie, le rejeter, vaille que vaille, au nombre des vices : la foule n'est déjà que trop portée à s'asservir aux plaisirs, mieux vaut donc s'engager sur la voie opposée : puisse-t-elle ainsi atteindre un juste milieu. Mais c'est bien mal raisonner.
Car en matière d'affections et d'actions les paroles ont moins de force persuasive que les actes, et lorsqu'elles sont en désaccord avec les données de la sensation, on les rejette, et, avec elles, la part de vérité qu'elles contiennent. Qu'un jour on surprenne le censeur des plaisirs à en rechercher un, on en conclura que tout plaisir mérite d'être poursuivi, car il est des distinctions que n'opère pas la foule. Il est donc préférable de toujours dire la vérité, en morale comme en science ; seules les paroles véridiques ont force oratoire ; conformes au réel, elles peuvent inciter ceux qui les entendent à y conformer leur vie.